𝗔𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲/𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 : 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿𝗾𝘂𝗼𝗶 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗲 𝘀𝗲 𝗿𝗲́𝘀𝘂𝗺𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝘁𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗮̀ 𝘂𝗻 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝟭.𝟰 : 𝟭
- Accueil
- Blogue
- 𝗔𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲/𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 : 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿𝗾𝘂𝗼𝗶 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗲 𝘀𝗲 𝗿𝗲́𝘀𝘂𝗺𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝘁𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗮̀ 𝘂𝗻 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝟭.𝟰 : 𝟭
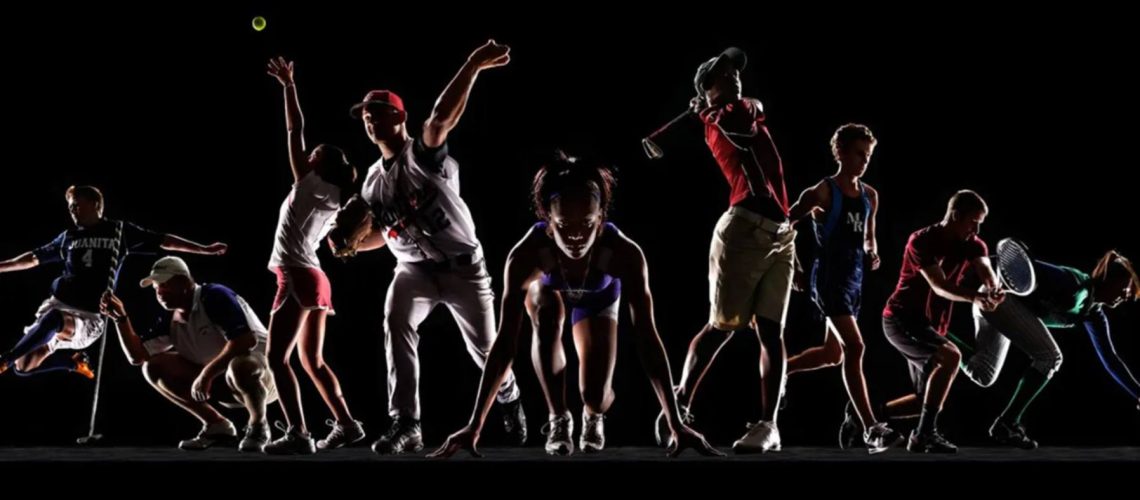
Équipe Éditoriale
𝗔𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲/𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 : 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿𝗾𝘂𝗼𝗶 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗲 𝘀𝗲 𝗿𝗲́𝘀𝘂𝗺𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝘁𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗮̀ 𝘂𝗻 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝟭.𝟰 : 𝟭
Le développement de la force excentrique représente une composante essentielle de la performance athlétique moderne. Contrairement à la force concentrique, qui correspond à la capacité d’un muscle à produire une action en se raccourcissant, la force excentrique se définit comme la capacité à résister à un allongement sous tension.
Autrement dit, la phase excentrique est celle du freinage, du contrôle et de l’absorption des forces. Elle intervient lors d’un atterrissage, d’une décélération, d’un changement de direction ou de toute situation où le corps doit gérer une contrainte externe avant de produire une nouvelle action.
L’importance de la force excentrique
Plusieurs raisons justifient l’importance du travail excentrique dans une programmation complète :
- Prévention des blessures et contrôle neuromusculaire : La majorité des blessures sportives surviennent dans les phases de décélération, d’atterrissage ou de réception. Une musculature excentriquement forte permet d’absorber et de redistribuer les charges plus efficacement, réduisant ainsi les contraintes sur les tendons et les articulations.
- Adaptation musculaire et tendineuse : Les contractions excentriques permettent de manipuler des charges plus lourdes que les contractions concentriques. Cela génère une tension mécanique élevée, favorable à la croissance musculaire, à la densité tendineuse et à l’amélioration du contrôle moteur.
- Transfert à la performance : De nombreux gestes athlétiques exigent la capacité non seulement de produire de la force, mais aussi de freiner et de stabiliser rapidement avant de réaccélérer. Une base excentrique solide conditionne donc la qualité de la phase concentrique suivante.
Une approche basée sur le ratio de force excentrique/concentrique
Une approche moderne de la préparation physique propose d’analyser le ratio entre la force excentrique et la force concentrique afin d’adapter l’entraînement au profil de l’athlète et aux exigences du sport pratiqué.
Selon cette approche, il existe toujours un écart naturel entre les deux types de force. Les muscles étant capables de produire environ 20 à 40 % plus de force en phase excentrique qu’en phase concentrique. Toutefois, cet écart peut être modifié volontairement selon les besoins fonctionnels du sport.
Cette différence est parfois appelée « déficit de force », c’est-à-dire la différence entre la capacité de produire de la force (concentrique) et la capacité de la contrôler (excentrique). Le but de l’entraînement devient alors d’optimiser cet écart, soit en le réduisant pour certains sports, soit en le creusant pour d’autres.
Pourquoi viser des écarts différents selon les sports ?
Tous les sports ne requièrent pas le même rapport entre ces deux formes de force. Le contexte biomécanique, la fréquence des décélérations, les exigences de contrôle moteur et la nature des efforts déterminent l’écart optimal à viser.
Sports nécessitant un grand écart (force excentrique largement supérieure)
Certains sports demandent que la force excentrique soit nettement plus élevée que la concentrique. C’est le cas des disciplines où les athlètes doivent freiner, absorber ou contrôler des forces externes importantes :
- Sports de contact et de duel : la plupart des arts martiaux incluant du combat avec lutte. Les athlètes doivent résister à des charges externes ou contrôler un adversaire en mouvement.
- Sports à décélérations répétées : soccer, basketball, handball, football. Les changements de direction imposent des contraintes excentriques majeures.
Dans ces disciplines, un écart important est bénéfique : il offre une réserve de stabilité et une sécurité lors des freinages intenses, tout en permettant une transition rapide vers la phase concentrique suivante.
Sports nécessitant un écart plus faible (ratio équilibré)
D’autres disciplines tirent davantage profit d’un ratio plus équilibré, où la force excentrique est seulement légèrement supérieure à la concentrique. C’est le cas de sports où la production de force pure, la constance et la coordination fine priment :
- Sports de force (powerlifting, haltérophilie, musculation) : l’efficacité repose sur la capacité à produire une force maximale concentrique. La phase excentrique reste importante pour le contrôle, mais l’écart ne doit pas être trop prononcé.
- Sports d’endurance avec force contrôlée : cyclisme, aviron, cross-country. Une trop grande dominance excentrique pourrait être énergétiquement coûteuse.
- Sports de précision et d’habileté : golf, tennis, escrime. Ces disciplines exigent un rapport fluide entre décélération et accélération, sans excès de tension.
Dans ces cas, le développement de la force excentrique vise surtout à améliorer la stabilité et la symétrie, sans altérer la rapidité ni la coordination.
Mais Simon, pourquoi avoir un ratio excentrique/concentrique 1.4 :1 nuirait à un sport concentrique ? C’est prouvé que c’est le ratio parfait pour la performance ?
Tu as raison de questionner ça.
Le point clé est le suivant : être ~40 % plus fort en excentrique que concentrique est “normal” chez l’humain (constaté en labo) et ce n’est pas un problème en soi. Ce ratio reflète la physiologie (les muscles résistent mieux qu’ils ne poussent) et varie surtout avec la vitesse du mouvement et d’autres facteurs (articulation, âge, etc.).
Alors, pourquoi parle-t-on parfois d’un « écart trop grand » qui pourrait nuire dans un sport surtout concentrique (p. ex. pousser/sprinter/sauter) ?
Ce n’est pas parce que l’excentrique “trop fort” nuirait à la capacité concentrique. C’est plutôt une question de spécificité d’entraînement et d’allocation du temps :
- Spécificité du mode de contraction : L’entraînement excentrique améliore davantage la force excentrique que l’entraînement concentrique n’améliore l’excentrique. À l’inverse, la concentrique est mieux développée… par la concentrique. Bref : on gagne surtout là où on s’entraîne. Donc si on sur-dose l’excentrique dans un sport qui exige prioritairement de la production concentrique rapide, on optimise moins bien la qualité réellement décisive le jour J.
- Transfert partiel vers la concentrique : Les revues et méta-analyses montrent souvent que l’excentrique surpasse la concentrique pour… la force excentrique. Pour la force concentrique et l’isométrique, l’avantage est moins clair ou non significatif si on compare “excentrique-seul” vs “concentrique-seul”. Conclusion pratique : si ton sport est fortement concentrique, négliger la concentrique au profit d’un énorme volume excentrique limite le rendement spécifique.
- Effets de fatigue et de timing : Les blocs excentriques lourds peuvent générer plus de dommages musculaires et de courbatures (DOMS). Mal placés (trop près des séances de puissance ou des compétitions), ils peuvent dégrader temporairement la vitesse/power concentrique par simple fatigue résiduelle, même si, bien planifiés, ils peuvent aussi booster précisément la vitesse concentrique (ex. surcharge excentrique avant un front squat puissant). Tout est dans la périodisation.
- Individualisation du ratio : Le fameux ~40 % est une moyenne. Il fluctue avec la vitesse testée, l’articulation et le profil de l’athlète. Dans la salle, “trop grand écart” veut dire, concrètement, que l’athlète a une capacité de freinage (excentrique) qui progresse plus vite que sa capacité de propulsion (concentrique) utile à son sport. À partir de là, la priorité devient de rééquilibrer la programmation (plus de concentrique à la bonne vitesse, contrastes, balistique) pour maximiser la performance spécifique.
À retenir (simple)
- Non, avoir ~40 % de plus en excentrique n’est pas “mauvais” : c’est la norme dite optimal, mais pour qui ?
- Ce qui peut nuire à un sport très concentrique, c’est sur-investir l’excentrique au détriment du développement concentrique spécifique (mode + vitesse), surtout si le timing de charge excentrique perturbe les séances de puissance.
- Bien planifié, l’excentrique est complémentaire : il protège, améliore la décélération et peut même améliorer la puissance concentrique quand il est utilisé aux bons moments et dosages.
Synthèse
Le développement optimal de la force excentrique ne consiste pas simplement à la renforcer de manière uniforme. Il s’agit plutôt de gérer intelligemment le ratio excentrique/concentrique selon les besoins spécifiques du sport et le profil de l’athlète.
- Dans les sports à haute exigence de freinage, d’absorption ou de contact, un écart important est recherché.
- Dans les sports de production de force ou de précision, un écart plus restreint favorise la cohérence et la fluidité du geste.
Cette approche rationnelle permet d’orienter la programmation non plus seulement vers la “force maximale”, mais vers une force fonctionnelle, équilibrée et transférable.
Elle incite les entraîneurs à évaluer, planifier et ajuster de manière fine la relation entre contrôle et production, garantissant ainsi un développement plus complet de la performance.
Référence:
Nuzzo, J. L., Pinto, M. D., Nosaka, K., & Steele, J. (2023). The Eccentric : Concentric Strength Ratio of Human Skeletal Muscle In Vivo – Meta-analysis of the Influences of Sex, Age, Joint Action, and Velocity. Sports Medicine, 53(6), 1125-1136.
https://doi.org/10.1007/s40279-023-01851-y
Roig M, O’Brien K, Kirk G, Murray R, McKinnon P, Shadgan B, Reid WD. The effects of eccentric versus concentric resistance training on muscle strength and mass in healthy adults: a systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med. 2009 Aug;43(8):556-568. doi:10.1136/bjsm.2008.051417. Epub 2008 Nov 3. PMID: 18981046.
Hody, S., Croisier, J.-L., Bury, T., Rogister, B., & Leprince, P. (2019). Eccentric Muscle Contractions: Risks and Benefits. Frontiers in Physiology, 10, 536. https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00536
